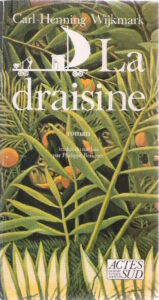Si je peux vous conseiller un livre, ce sera “L’inconnu de la poste” de Florence Aubenas, qui nous avait déjà donné “Le Quai de Ouistreham”.
L’écriture d’Aubenas est documentaire par ses sujets, mais bien au-delà du journalisme, elle est littéraire par ses qualités. Alors que dans “Ouistreham” elle avait elle-même créé le récit — elle en était le personnage principal —, dans “L’inconnu de la poste” elle se veut surtout être témoin. À l’image de Günter Wallraff, qui se transforma en ouvrier immigré pour écrire “Ganz unten” (ou “Tête de Turc”) en 1986, l’Aubenas de “Ouistreham” était femme de ménage, dans les hôtels, les navires…, pour un roman d’immersion et d’investigation. Elle était tellement engagée dans son récit qu’elle a dû, si je m’en souviens, se mettre des freins.
Dans “L’inconnu de la poste”, elle est bien plus distante. Rares sont les pages où elle parle d’elle-même, de ce qu’elle fait. On ressent toutefois sa présence, même quand elle ne se mentionne pas. L’histoire qu’elle raconte l’a bousculée, et la façon dont elle la raconte bousculera le lecteur. Ce n’est pas un livre qu’on repose après l’avoir lu, pour passer à autre chose.
C’est un livre qui vous poursuit.
[Avertissement: Le texte ci-dessous révèle une partie du contenu du livre.]
Le récit est simple. Le matin du 19 décembre 2008, la postière de la petite agence de Montréal-la-Cluse (3500 habitants, dans le département de l’Ain) est assassinée de vingt-huit coups de couteau. Quelques milliers d’euros sont pris. La postière est une femme d’une quarantaine d’années, qui vient de se séparer de son mari, s’est installée avec “le nouveau”, et attend un enfant. Assez vite, la suspicion et les recherches s’orientent sur un marginal et toxicomane, habitant presqu’en face de l’agence postale, et arrivé au village en 2007. En fait, il s’agit d’un acteur à la fois célèbre et inconnu, Gérald Thomassin, César du meilleur jeune espoir masculin en 1991, pour “Le petit criminel”. Tant ses copains toxicomanes à Montréal-la-Cluse, que les proches de la victime, le petit monde local, la presse, la police et la justice le considéreront coupable de ce crime — il sera gardé à vue en mars 2009 et incarcéré en l’attente d’un procès de 2013 à 2016, puis placé sous contrôle judiciaire — jusqu’à la découverte fortuite d’un autre suspect en mai 2018, dont l’ADN correspond aux traces laissées sur la scène du crime et sur la victime. L’acteur Thomassin disparaît pourtant le 29 août 2019, le jour où une ultime confrontation devait conclure le dossier. Quelques mois plus tard, en juin 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon confirme un non-lieu à son égard. “Il y a tout lieu de penser qu’à nouveau convoqué par la justice en 2019, onze ans après les faits, Gérald Thomassin n’a pas supporté cette perspective et qu’il s’est suicidé, alors qu’il était pourtant déterminé à se rendre à la convocation” conclut-elle — et conclut Florence Aubenas son livre, à trois petites pages près.
[Le hasard des lectures a fait que, juste avant “L’inconnu de la poste”, je venais de terminer “De sang-froid” (“In Cold Blood”) de Truman Capote (1966), prototype du roman non-fictionnel au sujet d’un assassinat particulièrement sanglant: deux assassins pour quatre victimes dans un village perdu du Kansas. Avec cette différence qu’Aubenas est entrée dans son récit en s’intéressant au suspect principal, alors que Truman Capote est parti d’un crime dont on ignorait alors les auteurs, qui furent ensuite identifiés, arrêtés, jugés, condamnés à mort et pendus. L’une comme l’autre se sont engagés dans un long travail dont ils ne pouvaient connaître l’aboutissement — la disparition de Gérald Thomassin pour l’une, l’identification des assassins et leur condamnation et mise à mort pour l’autre — et se sont longtemps entretenus avec ces suspects, tous des marginaux: coupable idéal dans un cas, coupables réels dans l’autre. Il apparaît même — ou serait-ce le choix des auteurs et leurs livres? — que la population du village états-unien, sa police et sa justice se soient comportées de façon plus humaine à l’égard des coupables que leurs homologues françaises à l’égard d’un suspect — à l’exception notable de la loi, qui au Kansas impose la peine de mort.]
“un monstre est entré dans la ville et nous voulons qu’il soit arrêté et sévèrement puni”
[Avertissement: La réflexion qui suit au sujet de l’affaire de la postière est basée sur la seule lecture du livre, par lequel Florence Aubenas s’est approchée de la perspective de Gérald Thomassin, et pour lequel elle n’a pu parler qu’avec ceux et celles qui lui avaient donné leur accord.]
Il y a de quoi s’étonner quand on lit les éléments à charge, établis par la police et la justice après des années d’enquête, qui sont en gros que Thomassin habite près de la poste, porte toujours un couteau à cran, manque souvent d’argent et a parlé à ses copains d’entreprendre un braquage. Il est toxicomane et alcoolique, a été violent à l’égard de sa copine, et semble obsédé par la mort, par le meurtre et par la victime — il en a longuement parlé à deux dames rencontrées au cimetière, mimant comment le meurtre aurait pu être commis. Et puis, il y a… sa filmographie. On lui reproche même d’avoir offert un DVD de son dernier film à la future victime — “Le premier venu” — certaines scènes étant interprétées comme des menaces.
Ou quand le journal Le Progrès annonce l’arrestation en 2013, écrivant “Le meurtre de Catherine Burgod, responsable de l’agence postale du vieux Montréal, à Montréal-la-Cluse, vient peut-être de trouver son épilogue, avec l’arrestation d’un homme qui a été interpellé sur la base d'”indices graves et concordants”, selon une source judiciaire. Une piste plus que sérieuse alors que l’enquête avait piétiné durant tant d’années. L’ADN a fini par parler pour aboutir à l’interpellation de ce suspect, dont l’implication paraît sérieuse et dont le profil correspond à celui d’un braqueur. Il vient d’être placé en garde à vue pour être longuement interrogé sur sa présence ce jour-là sur les lieux du crime, mais il a nié fermement être l’auteur du meurtre.” L’affirmation au sujet de l’ADN est manifestement fausse, les autres sont plus simplement erronées (profil d’un braqueur, présence sur le lieu du crime…).
Ce faisant, la justice passe outre l’absence de toute trace de sang de la victime sur Thomassin, sur son couteau et dans son appartement, alors que le meurtre a été particulièrement sanglant et qu’un moyen redoutable, le Bluestar, a été utilisé pour en chercher. Elle écarte la présence de traces d’ADN d’un inconnu, qui ont pourtant suffi pour dédouaner tous les autres suspects possibles. Et elle néglige le rapport de Thomassin à l’argent, car quand il en a besoin (toujours un peu), il le quête ou le demande — et l’obtient —, et quand il en possède beaucoup (comme après avoir joué dans un film), il le distribue généreusement. Or personne ne sait où le butin du meurtre-braquage est resté. Même le soir du crime, Thomassin est sans le sou, il tape quelques euros à un voisin pour acheter une rose.
La justice a voulu avoir un suspect, un coupable. Elle se l’est construit. Le petit monde de Montréal-la-Cluse et la presse le lui avaient réclamé. La famille et les proches aussi, parfois violemment, en actes et en paroles — le père de la victime est plutôt du genre potentat local, teinté de népotisme, et l’ex est violent. La justice s’est choisi un marginal et quelques coïncidences bien minces (l’adresse et le couteau), a oublié ce qui ne colle pas (l’ADN, le rapport à l’argent) et transformé une filmographie en CV, une violence subie lors de la jeunesse en meurtre commis à l’âge adulte, et un petit cadeau en menace. Elle a poussé sa propre victime dans le profil qui lui convenait — un étranger au village où tout le monde se connaît —, jusqu’à ce qu’il se comporte en conséquence, et finit par y ressembler. Les choix et les actes de cette justice ont convaincu la population, dont l’opinion à son tour a su convaincre la justice.
Alors, la justice, a-t-elle tué?
Aurait-il été plus juste d’avouer qu’on ne savait pas?